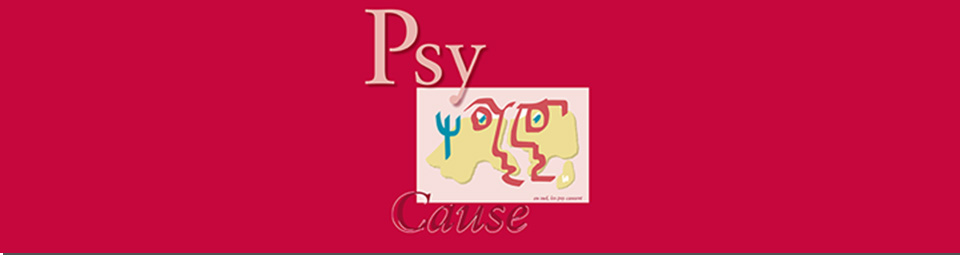Le suicide chez les amérindiens : 3 articles dans Psy Cause N°74
 Une étude sur le suicide des amérindiens a concerné trois articles : guyanais, québécois et ontarien.
Une étude sur le suicide des amérindiens a concerné trois articles : guyanais, québécois et ontarien.
Elle a eu pour point de départ le colloque de Saint Laurent du Maroni managé par le CHOG (Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais) en partenariat avec Psy Cause, les 20 et 21 mars 2017. Ce colloque fait l’objet d’une publication d’une grande partie des communications, dans un « Cahier Guyanais » dans le N°74 de la revue Psy Cause paru début novembre 2017. Ce qui correspond à un délai de publication très rapide que nous avons pu tenir grâce à un travail d’équipe entre notre représentant Psy Cause à Saint Laurent du Maroni, Mr Pascal Schindelholz, le directeur de la revue et notre infographiste à Avignon.
Lors du colloque de Saint Laurent du Maroni, l’anthropologue spécialiste des amérindiens de la Guyane Française, Mme Marianne Pradel, communique sur le thème du suicide dans cette population. Cette communication a intéressé deux psychiatres canadiens : le Dr Jean Dominique Leccia à Montréal, le Pr Raymond Tempier à Ottawa. Cela s’est concrétisé par trois textes dans notre N°74.
« J’ai cette peur de disparaître »
 Cette phrase est reprise par Marianne Pradel dans le titre de son article (Psy Cause N°74, pages 20 à 31) : « prononcée par un homme issu de l’un des six peuples premiers, survivants, de la Guyane, les Kali’na, elle ne peut absolument pas être entendue de manière anodine. Car il le précise : elle ne concerne pas que lui en tant qu’individu, mais tout son peuple. »
Cette phrase est reprise par Marianne Pradel dans le titre de son article (Psy Cause N°74, pages 20 à 31) : « prononcée par un homme issu de l’un des six peuples premiers, survivants, de la Guyane, les Kali’na, elle ne peut absolument pas être entendue de manière anodine. Car il le précise : elle ne concerne pas que lui en tant qu’individu, mais tout son peuple. »
Docteure en anthropologie sociale de l’EHESS à Paris, coordinatrice de la Cellule Régionale pour le Mieux Être des Populations de l’Intérieur à Cayenne, elle relie la problématique suicidaire à celle de  l’acculturation. L’éducation à l’école et à l’université, la « fréquentation des blancs », génèrent une perte de manières de faire et de vivre, dresse un mur entre les générations :
l’acculturation. L’éducation à l’école et à l’université, la « fréquentation des blancs », génèrent une perte de manières de faire et de vivre, dresse un mur entre les générations :
« Les adolescents désespèrent de n’avoir aucune relation verbale construite avec les adultes. Ils s’emmurent dans un refus de la tradition qui pourtant réapparaît dans des peurs sans résolution possible : les esprits sont présents mais moulinés au hachoir des religions nouvelles et du catholicisme, ils sont des diables. Les diables poussent au vice et au suicide. Et avec les diables on ne négocie pas ! On les expulse dans des rituels sonores, sonorisés même, sur un monde sympathique rappelant la culture mondiale mondialisée. »
L’amérindien se pose alors la question : « si mon peuple disparaît, qui vais-je devenir ? Dois-je déjà préparer ma survie dans un monde étranger ? Dois-je résister ? Dois-je m’armer et entrer dans une guerre contre les dominants ? Dois-je ignorer ce monde, le fuir par des substances ? Dois-je choisir le moment où moi-même je disparaîtrais ? Dois-je me sacrifier pour que d’autres, les miens, puissent faire corps et vaincre la malédiction qui pèse sur l’avenir commun ? » Comment trouver une place dans la modernité promise sans perdre sa singularité ?
Le premier constat, historique, est l’effondrement démographique. « Le contact avec les peuples européens venus faire la conquête d’un espace qu’ils jugent vierge, a eu pour conséquence immédiate la disparition d’un très grand nombre d’individus. » Il suffit de lire, écrit Marianne Pradel, la « Très brève relation de la destruction des Indes » de Las Casas, qui date de la toute première période de la colonisation au XVIème siècle, pour s’en convaincre. Tout la bassin amazonien y est décrit comme un territoire vierge, vide de populations. Or, de récentes recherches archéologiques n’hésitent pas à décrire des cités de plus de 300 000 âmes alimentées par une agriculture utilisant la « terra preta » sur des bassins de vie très étendus le long du Fleuve Amazone. Mais la mémoire historique a effacé jusqu’à ce souvenir. Il en est évidemment de même sur les terres qui constituent aujourd’hui la Guyane française. « Ainsi Jean Hurault montre que le seul bassin de l’Oyapoc aurait compté 15 000 âmes dans la deuxième moitié du XVIIème siècle, alors que déjà les premiers ravages avaient eu lieu. Cette même zone géographique abrite aujourd’hui à peine 2 000 habitants amérindiens. »
 Les épidémies et les guerres, poursuit Marianne Pradel, sont la principale cause de la disparition des peuples autochtones des Amériques ou en tous cas, et de manière générale, la principale cause invoquée. « Les maladies des Européens inconnues sur ce continent ont abattu des villages entiers. » Les ravages sanitaires ont été également la conséquence d’une politique visant à regrouper des « bandes », parfois avec l’intention louable de protéger. Mais la contagion répandue n’est pas seulement biologique : « armes à feu, alcool, prostitution forcée des femmes, enrôlement dans les guerres entre puissances conquérantes, soumission aux églises catholiques et protestantes ont détruit les fondations sociales. » Le prélèvement sur les réserves de poisson ou de gibier, l’abattage de larges bandes forestières pour permettre toutes sortes d’implantations humaines, l’introduction d’un commerce monétarisé et les choix politiques d’administration des territoires et des populations ont participé à la « déstructuration des modes de vie ». À cela s’ajoute le métissage qui est un mode de survie de ces populations numériquement très réduites.
Les épidémies et les guerres, poursuit Marianne Pradel, sont la principale cause de la disparition des peuples autochtones des Amériques ou en tous cas, et de manière générale, la principale cause invoquée. « Les maladies des Européens inconnues sur ce continent ont abattu des villages entiers. » Les ravages sanitaires ont été également la conséquence d’une politique visant à regrouper des « bandes », parfois avec l’intention louable de protéger. Mais la contagion répandue n’est pas seulement biologique : « armes à feu, alcool, prostitution forcée des femmes, enrôlement dans les guerres entre puissances conquérantes, soumission aux églises catholiques et protestantes ont détruit les fondations sociales. » Le prélèvement sur les réserves de poisson ou de gibier, l’abattage de larges bandes forestières pour permettre toutes sortes d’implantations humaines, l’introduction d’un commerce monétarisé et les choix politiques d’administration des territoires et des populations ont participé à la « déstructuration des modes de vie ». À cela s’ajoute le métissage qui est un mode de survie de ces populations numériquement très réduites.
« Ainsi ont disparu plus des deux tiers de la population autochtone de Guyane. Ceux qui vivent aujourd’hui, « entre tradition et modernité » comme le dit le slogan du village Kali’na d’Awala-Yalimapo, sont-ils assurés de ne pas faire partie de la prochaine catastrophe démographique ? Sont-ils assurés de leur identité en ce début de XXIème siècle ? » Pour l’amérindien qui se voit être l’un des derniers survivants, c’est une responsabilité très lourde de contenir tous les éléments de l’identité. D’autant plus que, de la survie, aucun amérindien de Guyane n’est assuré puisque « tous les esprits ont fui loin en forêt ».
 Marianne Pradem témoigne ainsi : « Lors du suicide d’un homme de vingt-cinq ans sur l’Oyapoc, l’un des proches m’exprime ainsi le sentiment d’impuissance face à cette nouvelle mort. Leur monde est devenu une sorte de désert ayant perdu ses forces profondes. Les auxiliaires que sont les esprits ont fui. Au sentiment d’impuissance, s’ajoute le danger : car si les alliés fuient, ils laissent la place aux plus mauvais d’entre eux. Les yeux brouillés de larmes, raide sur son banc, affecté par la succession de signaux que personne n’avait su repérer, lui-même touché par les tentatives de suicide de sa fille et la mort d’un de ses neveux par pendaison, mon interlocuteur cherchait quels moyens restaient à sa famille et à son peuple de se prémunir, pour faire un bouclier contre ces êtres qui viennent murmurer à l’oreille « Tue ton corps ». Car les morts par suicide ne quittent pas aisément l’environnement humain. Ils errent dans les limites du village et viennent habiter les rêves des proches. »
Marianne Pradem témoigne ainsi : « Lors du suicide d’un homme de vingt-cinq ans sur l’Oyapoc, l’un des proches m’exprime ainsi le sentiment d’impuissance face à cette nouvelle mort. Leur monde est devenu une sorte de désert ayant perdu ses forces profondes. Les auxiliaires que sont les esprits ont fui. Au sentiment d’impuissance, s’ajoute le danger : car si les alliés fuient, ils laissent la place aux plus mauvais d’entre eux. Les yeux brouillés de larmes, raide sur son banc, affecté par la succession de signaux que personne n’avait su repérer, lui-même touché par les tentatives de suicide de sa fille et la mort d’un de ses neveux par pendaison, mon interlocuteur cherchait quels moyens restaient à sa famille et à son peuple de se prémunir, pour faire un bouclier contre ces êtres qui viennent murmurer à l’oreille « Tue ton corps ». Car les morts par suicide ne quittent pas aisément l’environnement humain. Ils errent dans les limites du village et viennent habiter les rêves des proches. »
Marianne Pradem décrit alors un univers symbolique dans lequel les ordres animal, végétal et minéral ont des âmes spécifiques. Elle précise le rôle d’intermédiaire du chamane. Lequel perd son pouvoir. Pour les Amérindiens, le suicide n’est pas la « volonté de se tuer soi-même » mais la conséquence de l’action d’un esprit ou d’un sorcier. Cet esprit vient murmurer à l’oreille : « Tue ton corps ».
 Elle décrit les malentendus et les incompréhensions de l’administration, des caisses, pourvoyeuses de discontinuité dans les modes d’identification. Elle évoque les langues qui s’éteignent lentement effaçant des liens d’accès à une compréhension ancestrale du monde. Elle déplore l’impossibilité d’une entente entre les peuples amérindiens survivants de la Guyane. Les Chefs coutumiers sont politiquement très critiqués par les jeunes générations et leur action manque de lisibilité. Les histoires anciennes de conflits entre ethnies amérindiennes se racontent sur fond de sorcellerie. Elle décrit les tensions et malentendus au sein même des familles.
Elle décrit les malentendus et les incompréhensions de l’administration, des caisses, pourvoyeuses de discontinuité dans les modes d’identification. Elle évoque les langues qui s’éteignent lentement effaçant des liens d’accès à une compréhension ancestrale du monde. Elle déplore l’impossibilité d’une entente entre les peuples amérindiens survivants de la Guyane. Les Chefs coutumiers sont politiquement très critiqués par les jeunes générations et leur action manque de lisibilité. Les histoires anciennes de conflits entre ethnies amérindiennes se racontent sur fond de sorcellerie. Elle décrit les tensions et malentendus au sein même des familles.
Marianne Pradem conclut par les propos du chef coutumier Wayana Michel Opoya qui vient de mourir : avec lui, un monde a disparu : « Si nos ancêtres revenaient ici aujourd’hui, je suppose qu’ils penseraient s’être trompés de village ou bien que les amérindiens ont déjà disparus. Car tout a tellement changé en si peu de temps. Mais s’ils revenaient, j’aimerais les écouter nous raconter notre histoire parce nous avons oublié tant de choses. »
Kahnawake : atypies ou utopie
 Le second article (pages 32 à 39 de Psy Cause N°74) est rédigé par le Dr Jean Dominique Leccia, un psychiatre de Montréal d’origine corse. Personnage haut en couleurs, passionné par la question des minorités, Professeur adjoint à l’université McGill, il est le psychiatre d’une réserve amérindienne au sud de Montréal qui n’a pas hésité à se confronter à l’armée canadienne en 1990 sur une question identitaire. Il nous livre un contre exemple : celui d’une adaptation culturelle et identitaire réussie par les amérindiens de l’ethnie Mohawk.
Le second article (pages 32 à 39 de Psy Cause N°74) est rédigé par le Dr Jean Dominique Leccia, un psychiatre de Montréal d’origine corse. Personnage haut en couleurs, passionné par la question des minorités, Professeur adjoint à l’université McGill, il est le psychiatre d’une réserve amérindienne au sud de Montréal qui n’a pas hésité à se confronter à l’armée canadienne en 1990 sur une question identitaire. Il nous livre un contre exemple : celui d’une adaptation culturelle et identitaire réussie par les amérindiens de l’ethnie Mohawk.
Il écrit : « Le suicide, semble être devenu le baromètre de l’état de santé mentale des communautés amérindiennes. Au Canada, il y a un consensus parmi les chercheurs, les planificateurs ou les intervenants sur l’ampleur de ce phénomène. À savoir un taux global de suicides deux fois plus élevé que dans la population canadienne en général et qui serait 3 à 4 fois supérieur au Québec. » Sauf que, dans la réserve amérindienne de Kahnawake avec ses 8000 habitants, le taux de suicides est identique à la moyenne canadienne. Il ajoute : « Même si dans ma pratique le suicide est, comme pour tout psychiatre aujourd’hui, un souci permanent, il y est moins présent qu’aux urgences de l’hôpital de Châteauguay qui dessert certaines banlieues limitrophes sinistrées. »
 Jean Dominique Leccia évoque le contexte historique canadien qui a stoppé dans la seconde moitié du XIXème siècle le développement économique de Kahnawake, le plus grand village autochtone de l’est canadien, établi en 1676. L’Indian Act, en 1876, vise une assimilation. « Ces politiques répressives et ethnocidaires vont se poursuivre au XXe siècle, jusque dans les années 60. » En particulier l’envoi des enfants (qui sera traité dans le troisième article) dans des pensionnats religieux pour les éduquer. La résistance des Mohawks de Kahnawake a connu son point culminant en 1990 pour défendre l’intégrité de son territoire, un cimetière mohawk menacé par des promoteurs qui voulaient en faire un terrain de golf. Pendant un mois et demi, en bloquant le pont Mercier qui longe Kahnawake, « cordon ombilical entre Montréal et sa banlieue sud-ouest en plein développement, ils arrêtaient le flux des passages, évalué à deux millions de voitures par mois, obligeant la population à de longs détours, à de longues heures de trajet supplémentaire pour se rendre à leur travail ou pour revenir chez eux le soir. Un souvenir qui aujourd’hui s’estompe, mais la réserve malgré ses atouts suscite encore plus de méfiance que de curiosité chez ceux qui la traversent sans la voir dans leur transhumance quotidienne. »
Jean Dominique Leccia évoque le contexte historique canadien qui a stoppé dans la seconde moitié du XIXème siècle le développement économique de Kahnawake, le plus grand village autochtone de l’est canadien, établi en 1676. L’Indian Act, en 1876, vise une assimilation. « Ces politiques répressives et ethnocidaires vont se poursuivre au XXe siècle, jusque dans les années 60. » En particulier l’envoi des enfants (qui sera traité dans le troisième article) dans des pensionnats religieux pour les éduquer. La résistance des Mohawks de Kahnawake a connu son point culminant en 1990 pour défendre l’intégrité de son territoire, un cimetière mohawk menacé par des promoteurs qui voulaient en faire un terrain de golf. Pendant un mois et demi, en bloquant le pont Mercier qui longe Kahnawake, « cordon ombilical entre Montréal et sa banlieue sud-ouest en plein développement, ils arrêtaient le flux des passages, évalué à deux millions de voitures par mois, obligeant la population à de longs détours, à de longues heures de trajet supplémentaire pour se rendre à leur travail ou pour revenir chez eux le soir. Un souvenir qui aujourd’hui s’estompe, mais la réserve malgré ses atouts suscite encore plus de méfiance que de curiosité chez ceux qui la traversent sans la voir dans leur transhumance quotidienne. »
L’article de Jean Dominique Leccia pointe les éléments de résilence : une communauté enracinée, l’activisme politique, la résistance pour défendre son territoire, une relative harmonie environnementale et le confort de vie au sein d’un habitat typique des quartiers périphériques nord américains. Il ajoute : « La communauté mohawk a la certitude de son identité. De celle aussi de la communauté amérindienne dans son ensemble. Une affirmation qui au niveau individuel protège. Et une capacité à échanger avec la société dominante dont elle connait les codes et souvent les partage. »
 « À Kahnawake, le territoire enraciné de la réserve est investi : pour certains de mes patients, il est leur seul univers de vie ; il est référentiel pour tous. Ensuite récupération de la langue, activisme politique et création culturelle, en accord avec la tradition orale. La communauté possède une école élémentaire en immersion totale mohawk, et des écoles secondaires où cette identité est largement présente. Elle possède aussi ses propres médias, chaines de radio et de télévision, avec son feuilleton Mohawk Girls et ses journaux, ou les gens peuvent se retrouver. L‘hebdomadaire « Eastern Door » a reçu le titre de meilleur journal communautaire, et de meilleure page éditoriale dans cette même catégorie. Bien sûr pour cette cure sociétale, d’autres propositions sont avancées, économiques, sociales ou sanitaires. Nous avons choisi ces deux premières car elles sont plus spécifiques aux communautés amérindiennes. Peu d’entre elles peuvent se payer une véritable renaissance culturelle avec chanteur musicien créateur, même si partout elle émerge, confortée par l’actuelle politique du gouvernement canadien. Ainsi, si Kahnawake n’a pas connu de vague suicidaire, si son taux de suicide n’est pas plus élevé que la moyenne canadienne, c’est sans doute parce que ses conditions de vie sont décentes, et que son identité assumée peut s’exprimer. »
« À Kahnawake, le territoire enraciné de la réserve est investi : pour certains de mes patients, il est leur seul univers de vie ; il est référentiel pour tous. Ensuite récupération de la langue, activisme politique et création culturelle, en accord avec la tradition orale. La communauté possède une école élémentaire en immersion totale mohawk, et des écoles secondaires où cette identité est largement présente. Elle possède aussi ses propres médias, chaines de radio et de télévision, avec son feuilleton Mohawk Girls et ses journaux, ou les gens peuvent se retrouver. L‘hebdomadaire « Eastern Door » a reçu le titre de meilleur journal communautaire, et de meilleure page éditoriale dans cette même catégorie. Bien sûr pour cette cure sociétale, d’autres propositions sont avancées, économiques, sociales ou sanitaires. Nous avons choisi ces deux premières car elles sont plus spécifiques aux communautés amérindiennes. Peu d’entre elles peuvent se payer une véritable renaissance culturelle avec chanteur musicien créateur, même si partout elle émerge, confortée par l’actuelle politique du gouvernement canadien. Ainsi, si Kahnawake n’a pas connu de vague suicidaire, si son taux de suicide n’est pas plus élevé que la moyenne canadienne, c’est sans doute parce que ses conditions de vie sont décentes, et que son identité assumée peut s’exprimer. »
Jean Dominique Leccia observe que, lorsque l’on compare Kahnawake à d’autres communautés amérindiennes du Québec en difficulté, le taux de suicide qui frappe les communautés amérindiennes a plus à voir avec leurs conditions de survie, qu’avec leur profil ethnique et culturel. Une confusion trop souvent entretenue par les médias alors que précisément l’acculturation au profit d’une culture de survie est dénoncée comme facteur négatif dans les études épidémiologiques.
 Il conclut sur le fait que l’avenir des amérindiens n’est pas de les conserver dans des sortes de musées ethnographiques mais de considérer qu’une communauté doit avoir la capacité de s’intégrer aux grands courants d’une civilisation planétaire : « Nous ne sommes plus dans des situations de face-à-face culturel aux origines de l’ethnopsychiatrie. Avec l’avènement d’une culture planétaire, la psychiatrie transculturelle qui lui succède est plus orientée sur les effets mentaux liés au chevauchement des cultures. Elle intervient auprès de groupes ou d’individus, dans leurs difficultés parfois à concilier et à intégrer leur identité originelle, dans ce véritable patchwork culturel et identitaire qui aujourd’hui occupe notre espace, lui aussi fractionné. Nos géographies qui s’entrecroisent ne sont plus simplement physiques, mais aussi médiatiques, électroniques et virtuelles, qui elles mêmes génèrent de nouvelles appartenances, il y a des Mohawks de diverses obédiences religieuses ou idéologiques, des Mohawks gothiques par exemple. Tout notre capital identitaire est sollicité dans notre travail thérapeutique dans cette société perméable et tolérante, Il ne vise pas le cœur de son identité. Il vise simplement à redonner au sujet sa mobilité en harmonie avec son environnement, dans une culture où les premiers pas d’un enfant sont célébrés. »
Il conclut sur le fait que l’avenir des amérindiens n’est pas de les conserver dans des sortes de musées ethnographiques mais de considérer qu’une communauté doit avoir la capacité de s’intégrer aux grands courants d’une civilisation planétaire : « Nous ne sommes plus dans des situations de face-à-face culturel aux origines de l’ethnopsychiatrie. Avec l’avènement d’une culture planétaire, la psychiatrie transculturelle qui lui succède est plus orientée sur les effets mentaux liés au chevauchement des cultures. Elle intervient auprès de groupes ou d’individus, dans leurs difficultés parfois à concilier et à intégrer leur identité originelle, dans ce véritable patchwork culturel et identitaire qui aujourd’hui occupe notre espace, lui aussi fractionné. Nos géographies qui s’entrecroisent ne sont plus simplement physiques, mais aussi médiatiques, électroniques et virtuelles, qui elles mêmes génèrent de nouvelles appartenances, il y a des Mohawks de diverses obédiences religieuses ou idéologiques, des Mohawks gothiques par exemple. Tout notre capital identitaire est sollicité dans notre travail thérapeutique dans cette société perméable et tolérante, Il ne vise pas le cœur de son identité. Il vise simplement à redonner au sujet sa mobilité en harmonie avec son environnement, dans une culture où les premiers pas d’un enfant sont célébrés. »
Le suicide en milieu autochtone au Canada : un problème de culture ?
Le Pr Raymond Tempier est l’auteur du troisième article (pages 40 à 42, Psy Cause N°74). Professeur titulaire de psychiatrie à l’université d’Ottawa, psychiatre à l’Hôpital francophone Montfort d’Ottawa où il avait organisé pour Psy Cause en 2013 un congrès sur les minorités, il a pris une part importante dans la conception de notre Cahier Franco-Ontarien du N°71 (en ligne dans la rubrique Anciens Numéros sur notre site). Intervenant dans le grand nord ontarien, il a tout de suite été concerné par cette question du suicide chez les améridiens.
 Selon lui, il ne fait aucun doute que le suicide parmi les peuples autochtones est un problème de santé important et dramatique au Canada, comme ailleurs dans le monde. « Pour le Canada, c’est non seulement un vaste problème de santé mentale mais aussi un problème de santé publique actuel et pressant. » Raymond Tempier s’intéresse tout particulièrement aux travaux de la Commission de Vérité et Réconciliation du Canada a été mise en œuvre en 2008 pour informer les Canadiens des dures réalités du système des pensionnats indiens. Une commission qui dénonce les effets de l’assimilation forcée. « La CVR a servi à jeter les assises d’une réconciliation entre tous les Canadiens non autochtones mais aussi entre les divers paliers de gouvernement provinciaux et fédéraux et les peuples autochtones. La CVR a récemment publié un rapport axé sur tous les aspects du statut des peuples des Premières Nations, y compris leur état de santé. Ce rapport a identifié un nombre important de recommandations dont celui de diminuer les taux de suicide – ce qui est considéré comme un indicateur des progrès accomplis en santé – et de réduire l’écart de ces taux entre communautés autochtones et non autochtones. »
Selon lui, il ne fait aucun doute que le suicide parmi les peuples autochtones est un problème de santé important et dramatique au Canada, comme ailleurs dans le monde. « Pour le Canada, c’est non seulement un vaste problème de santé mentale mais aussi un problème de santé publique actuel et pressant. » Raymond Tempier s’intéresse tout particulièrement aux travaux de la Commission de Vérité et Réconciliation du Canada a été mise en œuvre en 2008 pour informer les Canadiens des dures réalités du système des pensionnats indiens. Une commission qui dénonce les effets de l’assimilation forcée. « La CVR a servi à jeter les assises d’une réconciliation entre tous les Canadiens non autochtones mais aussi entre les divers paliers de gouvernement provinciaux et fédéraux et les peuples autochtones. La CVR a récemment publié un rapport axé sur tous les aspects du statut des peuples des Premières Nations, y compris leur état de santé. Ce rapport a identifié un nombre important de recommandations dont celui de diminuer les taux de suicide – ce qui est considéré comme un indicateur des progrès accomplis en santé – et de réduire l’écart de ces taux entre communautés autochtones et non autochtones. »
 Le Pr Raymond Tempier avance que l’on sait que la culture et la langue jouent un rôle important dans l’augmentation des suicides dans ces communautés aborigènes. Ainsi, par exemple, Chandler a montré que des taux de suicide plus faibles chez les communautés autochtones de Colombie-Britannique existent là où la langue maternelle est encore parlée. Pour cet auteur, le suicide représenterait le « canari dans la mine » face à la détresse culturelle que vivent les populations autochtones. Une étude récente a montré chez les peuples Inuits qu’il y a des facteurs de risque ‘classiques’ comme la maltraitance dans l’enfance, l’histoire familiale de troubles dépressifs, la toxicomanie et les troubles de la personnalité de groupe B (en particulier les troubles limites). Mais il y a plus que cela, car chez ces peuples de l’extrême Nord Canadien, les facteurs de risque de suicide sont aussi associés au processus de colonisation, à la dépossession des territoires, à la perte de leur culture et à la rupture de liens sociaux traditionnels. « Lorsque les communautés manquent de sens à leur vie et de continuité culturelle, le risque augmente davantage, il est donc important pour ces personnes en processus de perte culturelle de retrouver leurs traditions et leur histoire mais aussi leur langue. »
Le Pr Raymond Tempier avance que l’on sait que la culture et la langue jouent un rôle important dans l’augmentation des suicides dans ces communautés aborigènes. Ainsi, par exemple, Chandler a montré que des taux de suicide plus faibles chez les communautés autochtones de Colombie-Britannique existent là où la langue maternelle est encore parlée. Pour cet auteur, le suicide représenterait le « canari dans la mine » face à la détresse culturelle que vivent les populations autochtones. Une étude récente a montré chez les peuples Inuits qu’il y a des facteurs de risque ‘classiques’ comme la maltraitance dans l’enfance, l’histoire familiale de troubles dépressifs, la toxicomanie et les troubles de la personnalité de groupe B (en particulier les troubles limites). Mais il y a plus que cela, car chez ces peuples de l’extrême Nord Canadien, les facteurs de risque de suicide sont aussi associés au processus de colonisation, à la dépossession des territoires, à la perte de leur culture et à la rupture de liens sociaux traditionnels. « Lorsque les communautés manquent de sens à leur vie et de continuité culturelle, le risque augmente davantage, il est donc important pour ces personnes en processus de perte culturelle de retrouver leurs traditions et leur histoire mais aussi leur langue. »
L’article cite un psychiatre des Etats Unis qui est métis Cherokee et Lakota, Lewis Mehl Madrona, qui a mis au point une thérapie culturelle adaptée : la thérapie narrative. (Ce psychiatre était venu communiquer à notre congrès d’Ottawa). « La thérapie narrative semble être un moyen prometteur et aide les « clients » à construire une identité narrative en continuité avec leurs problèmes personnels. » L’auteur conclut sur une note optimiste quant à l’avenir des amérindiens au Canada, de par la recherche de solutions qui permettent un accès à la « sécurité culturelle », tant dans les communautés isolées que dans les grandes villes.
Jean Paul Bossuat
Pour commander le N°74 de la revue Psy cause, écrire à psycause.info@gmail.com