Rochegude III : « Les processus de création ». 9 avril 2016. Volet N°2
Nous reprenons le fil du compte rendu du colloque Rochegude III avec la troisième communication de la matinée qui, après deux interventions pointues, nous propose une excursion dans la thérapie par l’humour…
« Clown et thérapie » : l’auteure de cette communication de terrain est Mme Bénédicte Carrière, art-thérapeute à Montpellier et membre du bureau de l’ARAT.
 « Je voudrais aujourd’hui partager avec vous mon expérience en tant que thérapeute utilisant le médium clown durant des séances groupales », annonce t’elle. Ses séances de groupe démarrent graduellement sur le mode de l’échauffement, s’ouvrent à des propositions de jeu (offrir une fleur, par exemple), le nez rouge faisant entrer dans le personnage. Elles sont très proches du théâtre d’improvisation. « Dans la veine des médiations thérapeutiques de René Roussillon, le clown est en effet devenu pour moi un médium, et le jeu de ce personnage, un médium malléable dont les fonctions ouvrent à la métaphore, la symbolisation, et la sensori- motricité par la théâtralisation qu’il engage », confie la communicante dont le propos est de nous faire partager ses pistes personnelles de réflexion théorique à partir de sa pratique.
« Je voudrais aujourd’hui partager avec vous mon expérience en tant que thérapeute utilisant le médium clown durant des séances groupales », annonce t’elle. Ses séances de groupe démarrent graduellement sur le mode de l’échauffement, s’ouvrent à des propositions de jeu (offrir une fleur, par exemple), le nez rouge faisant entrer dans le personnage. Elles sont très proches du théâtre d’improvisation. « Dans la veine des médiations thérapeutiques de René Roussillon, le clown est en effet devenu pour moi un médium, et le jeu de ce personnage, un médium malléable dont les fonctions ouvrent à la métaphore, la symbolisation, et la sensori- motricité par la théâtralisation qu’il engage », confie la communicante dont le propos est de nous faire partager ses pistes personnelles de réflexion théorique à partir de sa pratique.
Raymond Devos disait : « Les gens qui n’ont pas d’humour ne sont pas des gens sérieux ». On peut entendre qu’une personne qui prend tout au sérieux n’a aucun recul sur la dérision de son existence dans l’univers, sur son utilité, réelle ou supposée, au regard de la vie et de la mort. Avoir de l’humour, c’est tout d’abord ce pas de côté qui permet au quotidien d’être supportable, un questionnement renouvelé de nos valeurs, une interrogation philosophique sur l’étique ou la morale, voir la dénonciation de ce qui nous indigne. L’humour est donc une sortie du cadre qui permet dans le même temps d’accepter et de supporter ce cadre, en le remettant en question, en explorant ses contradictions et ses errances. « On pourrait ainsi dire que l’humour permet une respiration dans l’obsession, un espace de dédramatisation dans l’hystérie, un peu de sublimation dans la névrose. »
 Mme Bénédicte Carrière passe ensuite en revue quelques concepts psychanalytiques de Freud sur l’humour : le mot d’esprit qui sert à maintenir inconsciente l’idée qu’il exprime, est une sorte de raccourci qui, à la différence d’une pensée laborieuse qui s’efforcerait de métaboliser la vanité du monde et la petitesse de celui qui la réfléchit, nous offre de manière inattendue une réévaluation des exigences de cette réalité, aboutit à un renversement de l’affect tout en maintenant une représentation ; le comique qui réalise plutôt une épargne de représentation, en mettant en scène de façon condensée des idées qui nécessiteraient une grande mobilisation de moyens verbaux (Charlot, retournant dans une pâtisserie pour donner un bon coup de pied à celui qui l’a précédemment éjecté car il n’avait pas le sou, et qui repart derechef en courant, une petite moue satisfaite sous sa moustache, comme un galopin…) ; le rire qui, pour Freud, est « le surmoi qui s’efforce, par l’humour, de consoler le moi et à le préserver de la souffrance », comporte un aspect libérateur, en ce sens qu’il exprime le gain de plaisir qui découle de l’épargne d’un sentiment de déplaisir.
Mme Bénédicte Carrière passe ensuite en revue quelques concepts psychanalytiques de Freud sur l’humour : le mot d’esprit qui sert à maintenir inconsciente l’idée qu’il exprime, est une sorte de raccourci qui, à la différence d’une pensée laborieuse qui s’efforcerait de métaboliser la vanité du monde et la petitesse de celui qui la réfléchit, nous offre de manière inattendue une réévaluation des exigences de cette réalité, aboutit à un renversement de l’affect tout en maintenant une représentation ; le comique qui réalise plutôt une épargne de représentation, en mettant en scène de façon condensée des idées qui nécessiteraient une grande mobilisation de moyens verbaux (Charlot, retournant dans une pâtisserie pour donner un bon coup de pied à celui qui l’a précédemment éjecté car il n’avait pas le sou, et qui repart derechef en courant, une petite moue satisfaite sous sa moustache, comme un galopin…) ; le rire qui, pour Freud, est « le surmoi qui s’efforce, par l’humour, de consoler le moi et à le préserver de la souffrance », comporte un aspect libérateur, en ce sens qu’il exprime le gain de plaisir qui découle de l’épargne d’un sentiment de déplaisir.
Plus prosaïquement, la communicante constate : « après avoir ri, on se sent bien, ou mieux ; le rire nous détend. » Elle ajoute : « Parce que je suis passionnée par le personnage du clown, que j’éprouve en entrant dans ce personnage un grand bonheur, une jubilation mentale et physique, je me suis interrogée sur la place et la fonction de l’humour – qui est ultra prisé dans les relations sociales – et cela m’a posé la question de son usage éventuel dans l’exercice thérapeutique. » Elle attend de l’usage de l’humour en séances collectives, « la possibilité d’expérimenter, de communiquer et de verbaliser autrement des conflits impossibles à assumer s’ils sont exprimés sérieusement et sans voile, qui sont indicibles, ou pour certains, uniquement par un passage à l’acte. »
Mme Bénédicte Carrière entre à présent dans le vif du sujet : sa réflexion à partir de sa pratique :
 « Dans son jeu, proche me semble-t-il des productions de l’inconscient, et dans sa propension à être un sujet n’existant que par le regard de l’autre, le clown pourrait être le pendant métaphorique du sujet souffrant face au thérapeute. Le clown, ce double de l’autre qui passe si rapidement des larmes au rire, m’apparaît comme un possible vecteur dans le travail qu’effectue le thérapeute avec un groupe de patient. En effet, dans la mise en relief et en jeu de la poïétique de la personne et grâce à un cadre adéquat, un travail symboligène me parait pouvoir se mettre en route à l’aide du personnage clown, afin de rejouer autant que nécessaire ce qui échappe au conscient, afin d’inventer des solutions, qui, tout en n’étant que clownesques, favorisent et engagent la capacité créatrice et imaginative du sujet.
« Dans son jeu, proche me semble-t-il des productions de l’inconscient, et dans sa propension à être un sujet n’existant que par le regard de l’autre, le clown pourrait être le pendant métaphorique du sujet souffrant face au thérapeute. Le clown, ce double de l’autre qui passe si rapidement des larmes au rire, m’apparaît comme un possible vecteur dans le travail qu’effectue le thérapeute avec un groupe de patient. En effet, dans la mise en relief et en jeu de la poïétique de la personne et grâce à un cadre adéquat, un travail symboligène me parait pouvoir se mettre en route à l’aide du personnage clown, afin de rejouer autant que nécessaire ce qui échappe au conscient, afin d’inventer des solutions, qui, tout en n’étant que clownesques, favorisent et engagent la capacité créatrice et imaginative du sujet.
La présence du groupe de patients qui fait public, permet de trouver d’autres regards et d’autres expériences de la répétition. Ceux-ci viennent faire écho à la souffrance comme au rire, mais aussi viennent porter l’espoir de prendre et de donner, on peut même dire d’élaborer et de subjectiver, grâce au jeu, un peu de soi et un peu de l’autre, dans l’échange tiers qui ouvre à la guérison. La communicante emploie le personnage du clown comme outil de « décalage » dans un groupe semi ouvert qui fonctionnera comme un atelier de clown « classique ». La séance proposée permet, grâce à la création d’un objet prétexte (lire René Roussillon. « Le je et l’entre je(u) ». Le Fil rouge. 2008), de trouver un chemin vers plus de plasticité psychique, ce qui, petit à petit pourrait autoriser à se jouer de certains mécanismes de défenses nuisant à l’économie psychique.
Un cadre est défini : les règles d’abstinence et de secret sur ce qui se passe durant la séance, les horaires, la ponctualité, le paiement etc. Chaque thérapeute, en fonction de son orientation psychanalytique, peut choisir ou non d’analyser les productions scéniques, c’est un choix méthodologique qui regarde chacun mais doit être signifié clairement aux personnes concernées.
Suite à la mise en place du cadre avec le groupe, la séance débute par des échauffements corporels simples, donnés par le thérapeute, qui permettent l’investissement de l’espace et la confrontation à la distance « juste » ( pour chacun) à l’autre, ainsi que la réappropriation de l’éprouvé libidinal du corps. Ces jeux de la mise en mouvement du corps, vus comme métaphores de la mise en mouvement psychique, sont proposés avec l’ensemble du groupe, dans l’espace, puis progressivement proposés à plusieurs, puis par deux. Ils amènent graduellement et de manière sécure à la rencontre à l’autre. Suite à ces jeux, il devient déjà plus facile de poser des mots sur cette rencontre de soi à soi, de soi à l’autre et de l’autre à l’autre : celui-ci est vécu comme imposant, effrayant, ou au contraire facile d’accès, accueillant… Petit à petit, une relation plus fluide s’instaure, Chacun peut se positionner face à cet autre, mais aussi peut respecter ses propres limites de manière plus claire.
 Je sépare en quatre espaces les lieux du dispositif clown en thérapie.
Je sépare en quatre espaces les lieux du dispositif clown en thérapie.
– L’espace « public » : c’est le lieu où les personnes regardent celui ou ceux qui se trouvent sur scène. C’est l’espace groupal de la catharsis où l’autre montre son je(u) ; lieu à la fois de repli et de réception, lieu scopique de l’échange, mais également lieu de l’interrogation : que fais le personnage, que fait l’autre, qu’est-ce que cela donne à ressentir ?
– L’espace scénique : c’est le lieu du jeu dans lequel il est obligatoire de « mettre » le nez de clown, où seul le personnage à le droit d’entrer et d’où il peut s’extraire par la liberté qu’il s’octroie, liberté énoncée dans le cadre. L’espace scénique est un lieu circonscrit et signifié comme tel par un espace défini. Ici le personnage clown est engagé à s’exprimer selon sa poïétique, sa poétique, sa lalangue, nous dirait Lacan. L’espace établi invite le patient à jouer tout en lui assurant une certaine sécurité : il peut expérimenter cet espace et en reconnaître les limites, ne pas se perdre, donc, peut-être, se retrouver. Grâce à son masque de clown qui protège son intimité, il pourra se montrer sans s’exposer. La personne « sur scène » dispose alors d’un public de semblables, d’autres en miroir, et d’un Autre en la présence tierce du thérapeute. La scène, c’est l’espace de subjectivation et d’objectivation.
– L’avant-scène, l’espace de « l’entre-deux » : cet espace très particulier entre le public et la scène permet de se trouver suffisamment à distance de l’autre, de s’en décoller et peut ainsi changer de forme et de taille en fonction des dispositifs. Ce lieu du « rien » est primordial, il organise la limite entre le dedans et le dehors, il donne corps à la séparation symbolique.
– La ou les coulisses : c’est l’espace où n’est pas le thérapeute, le lieu sans l’Autre (Jacques Lacan. « Le séminaire Livre XIII, L’objet de la psychanalyse ». février 66) où le sujet a le choix d’être sujet sans le regard d’un autre, sans l’effet scopique maternant, sans le soutien de la mère « good enough » ou, au contraire, dévoratrice. (Donald W.Winnicott. « La mère suffisamment bonne ». Petite Bibliothèque Payot. 2006) (Melanie Klein. « La psychanalyse des enfants ». Presse Universitaire de France. 2009). Le patient (qui la plupart du temps joue en binôme avec une autre personne du groupe) doit « entrer en scène », lieu social où il sera à la vue de tous et d’où il pourra se soustraire en sortant de scène si c’est ce qu’il souhaite. En cela il est constamment accueilli dans chacun de ses choix. Le lieu intime de la coulisse est un espace clos et sécure d’où l’on glisse d’un espace vers un autre, d’un statut à un autre ; symbolique d’une mise au monde sociale plus ou moins acceptée et/ou acceptable, jubilatoire ou angoissante, là où vont se rejouer de manière régressive des modes d’être au monde. La coulisse, c’est donc un lieu de jouissance, mais que l’on doit quitter pour devenir sujet. L’angoisse de « monter » sur scène est non seulement celle de la rencontre à l’autre (d’un miroir déformant) et des regards portés sur soi, mais surtout elle est l’expression de nos peurs archaïques, des rapports que nous entretenons avec nos figures originaires. (Besoin de plaire, de coller plus ou moins à la proposition de jeu, agressivité, parfois, avec le compagnon de scène…).
 Je travaille essentiellement avec l’improvisation. L’improvisation, c’est ce qui n’est pas préparé, ce qui se passe in situ, sur l’instant, c’est donc le processus créatif, prétexte et éphémère, demandé par la proposition de jeu. Par exemple : un clown offre une fleur à un autre clown, ou bien deux clowns se rencontrent à l’arrêt de bus. Ces consignes sont ainsi très simples, elles invitent à la rencontre avec le compagnon de scène (le socius) et le public. Il ne s’agit certainement pas de rejouer des conflits réels. Ces propositions sont des prétextes amenés pour que le sujet investisse l’objet clown. Il n’y a pas, dans l’improvisation, la possibilité temporelle de mentaliser, d’intellectualiser la parole, le jeu improvisé favorise de ce fait les associations libres. L’impro advient à la suite de tous les échauffements, jeux d’interactions et d’investissement du corps et de l’espace, jeux qui font parties intégrantes de la séance thérapeutique : le groupe a joué à zozoter, à tricoter des liens. Les personnes ont appris le silence de l’entre deux, à mettre de l’espace, du sens et du son, étonnées de se laisser surprendre par leurs ressentis. Elles se sont engagées peu à peu à accepter (plus ou moins) la surprise de ce qui va advenir, sans anticiper. C’est l’apprentissage du vivre avec et malgré l’autre, à faire avec la loi, l’ici et maintenant. Ce que joue le patient ce n’est pas la présentation de ce qu’il est, mais plutôt la représentation d’un autre de lui qui a un accès plus direct à sa chaîne signifiante. Un autre de lui qui rejouerait une partition inconsciente devant un miroir (le public et le thérapeute) dans l’attente qu’on le nomme comme sujet unique et désirable. (Jacques Lacan. « Le Stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans l’expérience psychanalytique ». Presses universitaires de France,1949). Avec son masque (le nez de clown) qui le met en lumière, le patient présente une autre parole de lui, qui détient et exprime une vérité décalée de ce qu’il donne quotidiennement à voire et à entendre.
Je travaille essentiellement avec l’improvisation. L’improvisation, c’est ce qui n’est pas préparé, ce qui se passe in situ, sur l’instant, c’est donc le processus créatif, prétexte et éphémère, demandé par la proposition de jeu. Par exemple : un clown offre une fleur à un autre clown, ou bien deux clowns se rencontrent à l’arrêt de bus. Ces consignes sont ainsi très simples, elles invitent à la rencontre avec le compagnon de scène (le socius) et le public. Il ne s’agit certainement pas de rejouer des conflits réels. Ces propositions sont des prétextes amenés pour que le sujet investisse l’objet clown. Il n’y a pas, dans l’improvisation, la possibilité temporelle de mentaliser, d’intellectualiser la parole, le jeu improvisé favorise de ce fait les associations libres. L’impro advient à la suite de tous les échauffements, jeux d’interactions et d’investissement du corps et de l’espace, jeux qui font parties intégrantes de la séance thérapeutique : le groupe a joué à zozoter, à tricoter des liens. Les personnes ont appris le silence de l’entre deux, à mettre de l’espace, du sens et du son, étonnées de se laisser surprendre par leurs ressentis. Elles se sont engagées peu à peu à accepter (plus ou moins) la surprise de ce qui va advenir, sans anticiper. C’est l’apprentissage du vivre avec et malgré l’autre, à faire avec la loi, l’ici et maintenant. Ce que joue le patient ce n’est pas la présentation de ce qu’il est, mais plutôt la représentation d’un autre de lui qui a un accès plus direct à sa chaîne signifiante. Un autre de lui qui rejouerait une partition inconsciente devant un miroir (le public et le thérapeute) dans l’attente qu’on le nomme comme sujet unique et désirable. (Jacques Lacan. « Le Stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans l’expérience psychanalytique ». Presses universitaires de France,1949). Avec son masque (le nez de clown) qui le met en lumière, le patient présente une autre parole de lui, qui détient et exprime une vérité décalée de ce qu’il donne quotidiennement à voire et à entendre.
L’improvisation, peut « s’apprendre », dans le sens où, peu à peu, au fil des séances, dans l’alliance thérapeutique engagée, chacun peut laisser advenir une part manquante au départ inconnue de lui, et jouer avec, dans la jubilation de la re-présentation d’un hors-cadre manifeste, grâce cet espace cadré (la scène) où la loi permet de jouer avec le phallus, puisque ici on fait « comme si », on fait semblant, on prend une forme de liberté, et le dérapage est dédramatisé dans l’humour.
Une seule séance thérapeutique avec le médium clown n’a donc pas vraiment de sens, si ce n’est de se faire plaisir ou, beaucoup moins agréablement, de mettre à jour, sans les traiter, des affects ou des conflits internes dérangeant, voir inquiétants. Le soin thérapeutique s’exerce, dans les séances que je propose, sans pointer le symptôme du sujet, en respectant le temps de la relation transférentielle, en le laissant s’approprier et s’imprégner petit à petit par les outils qui lui sont offerts : les effets de la création, les surgissements de la chaîne signifiante, le partage par le langage… Mais aussi, peut-être, par la reconnaissance d’être ce sujet-là, unique, dans son questionnement universel sur son identité. Celui qui vient représenter, de manière subjective, l’objet de son je(u), a besoin de se familiariser avec son propre mode de représentation(s), pour faire sien son mode de liberté, grâce sa manière toute particulière de détenir et de jouer avec sa jouissance, ses défenses, grâce à sa capacité à jouer avec le miroir du public et à ce qu’il intègre du retour, du reflet de ce miroir. (Jacques Lacan, « L’Angoisse » Livre X. 1962/63).
Après le jeu vient le temps d’une éventuelle élaboration et d’un possible partage de la parole.
Ce temps n’est qu’une proposition, donnée comme telle. Le silence doit être également proposé et accueilli : d’une manière ou d’une autre, c’est le silence est également un temps d’élaboration permettant l’intégration de l’expérience vécue. Chacun dans le groupe peut partager ses ressentis ou non : on exprime ou on écoute les émotions, les peurs, la jubilation. On dédramatise, la confusion peu parfois s’éloigner, se déliter. Avoir pu éprouver tous les espaces symboliques, de la scène aux coulisses, offre à chaque sujet de pouvoir appréhender des situations identiques, vues de lieux et de manières différentes. Effectivement, chacun sera tour à tour public ou personnage clown invité à entrer en scène. Chacun peut alors être le voyeur ou celui qui est vu, être à l’intérieur ou à l’extérieur (du personnage, du public, de la scène…) extérioriser ou intégrer, jouer ou se jouer de, détenir ou non le pouvoir, entrer dans le cadre et/ou en sortir… En passant par le jeu des mots, en retrouvant sa lalangue, ses peurs et ses découvertes d’enfant, le patient peut reconquérir une place de sujet. (Jacques Lacan. « Le Séminaire, Livre XXIII, Le Sinthome. Seuil. 1975/76).
Il ne faut pas omettre la dimension humoristique de ces séances. Si l’inquiétante étrangeté fait partie du processus comme témoin d’un surgissement du refoulé, la jubilation et le plaisir des sens sont les ingrédients non négligeables des séances clown en thérapie. (Sigmund Freud. « L’inquiétante étrangeté ». (Das Unheilmliche) 1919).
Un renforcement narcissique m’apparait évident chez la plupart des personnes qui ont suivi ces séances. Untel a intégré depuis un emploi en ESAT (alors qu’il n’avait jamais travaillé), tel autre, qui a partagé quelques séance avec des enfants, m’a expliqué qu’il était fier de leur avoir appris à faire le clown ! Je pense également à Monsieur M, qui me dit à chaque séance, qu’ « il ne sait pas faire », mais qui est « si fier de faire rire la galerie », comme il dit.
 Le cadre est toujours interrogé, c’est bien ce que je souhaite en tant que thérapeute, il est mis à mal dans l’humour, parfois transgressé dans l’utilisation d’une permission particulière car, oui, chacun est invité à explorer ses ressentis, à trouver d’autres réalités qui lui sont propres, pour en faire une re-présentation.
Le cadre est toujours interrogé, c’est bien ce que je souhaite en tant que thérapeute, il est mis à mal dans l’humour, parfois transgressé dans l’utilisation d’une permission particulière car, oui, chacun est invité à explorer ses ressentis, à trouver d’autres réalités qui lui sont propres, pour en faire une re-présentation.
Ce que nous dit René Roussillon dans « Le jeu et l’entre je(u) » c’est que « L’illusion inhérente au « jouer » est donc à l’origine d’une expérience subjective essentielle, celle qui permet de rencontrer, de percevoir et de s’approprier cette forme particulière de réalité qui est celle du symbole et des processus de symbolisation » (René Roussillon « Le jeu et l’entre je(u) ». Le fil rouge. Puf.P.82). »
Cette communication de terrain a été très appréciée et a suscité des échanges nombreux avec le public qui se poursuivront après la levée de la séance. Mme Marie José Pahin, en particulier, revient sur la fonction du surmoi : « l’humour est la transfiguration dans le comique, de la fonction du surmoi. Certains enfants sont horrifiés par le clown. Ce dernier permet un jeu avec un surmoi obscène et féroce. »
La pause déjeuner.
 Deux longues tables sont dressées selon un plan de table établi par le Dr Jean Louis Griguer. Nous en proposons à nos lecteurs un diaporama. La première photo est une vue panoramique (partielle) des congressistes partageant ce moment convivial.
Deux longues tables sont dressées selon un plan de table établi par le Dr Jean Louis Griguer. Nous en proposons à nos lecteurs un diaporama. La première photo est une vue panoramique (partielle) des congressistes partageant ce moment convivial.
 L’exécutif de Psy Cause a bien évidemment mis à profit ce temps de rencontre privilégiée lors de cette manifestation annuelle devenue une tradition, pour manifester la solidarité de ses membres toujours unis au sein d’une équipe rassemblée depuis trois années pour donner un nouvel élan et un nouvel horizon à l’association/revue Psy Cause. Rassemblée en 2013 dans la continuité d’une longue histoire commencée par deux d’entre eux, les Drs Jean Paul Bossuat et Thierry Lavergne, il y a 21 ans, cette équipe travaille pour développer Psy Cause dans un cadre francophone sur tous les continents, et aussi, ce qui est l’objet des colloques Rochegude, dans un cadre français. Quel que soit le contexte, elle œuvre conformément aux principes fondateurs.
L’exécutif de Psy Cause a bien évidemment mis à profit ce temps de rencontre privilégiée lors de cette manifestation annuelle devenue une tradition, pour manifester la solidarité de ses membres toujours unis au sein d’une équipe rassemblée depuis trois années pour donner un nouvel élan et un nouvel horizon à l’association/revue Psy Cause. Rassemblée en 2013 dans la continuité d’une longue histoire commencée par deux d’entre eux, les Drs Jean Paul Bossuat et Thierry Lavergne, il y a 21 ans, cette équipe travaille pour développer Psy Cause dans un cadre francophone sur tous les continents, et aussi, ce qui est l’objet des colloques Rochegude, dans un cadre français. Quel que soit le contexte, elle œuvre conformément aux principes fondateurs.
 Le Dr Jean Louis Griguer est le maître d’œuvre, au sein de Psy Cause, des Journées de Rochegude (au printemps 2014 sur les états limites, au printemps 2015 sur les troubles bipolaires, et en ce printemps 2016 sur les processus de création). Il a réuni autour de lui, lors de ce déjeuner, deux fidèles des Journées de Rochegude : le Pr Gérard Pirlot venu de Toulouse communiquer en 2014, 2015 et 2016, ainsi que le Dr Hugues Scharbach venu de Nantes communiquer en 2014 et 2016. Le Dr Jean Louis Griguer a exprimé sa satisfaction de ce troisième événement à Rochegude particulièrement réussi.
Le Dr Jean Louis Griguer est le maître d’œuvre, au sein de Psy Cause, des Journées de Rochegude (au printemps 2014 sur les états limites, au printemps 2015 sur les troubles bipolaires, et en ce printemps 2016 sur les processus de création). Il a réuni autour de lui, lors de ce déjeuner, deux fidèles des Journées de Rochegude : le Pr Gérard Pirlot venu de Toulouse communiquer en 2014, 2015 et 2016, ainsi que le Dr Hugues Scharbach venu de Nantes communiquer en 2014 et 2016. Le Dr Jean Louis Griguer a exprimé sa satisfaction de ce troisième événement à Rochegude particulièrement réussi.
 Ce colloque Rochegude III fait l’objet d’un partenariat, décidé lors de la réunion du 12 septembre 2015, avec une association qui fait la promotion de l’art-thérapie, basée à Béziers, l’ARAT. Lors de ce déjeuner, les président et vice président de Psy Cause International ont fait la connaissance du Dr François Granier, psychiatre au CHU de Toulouse où il dirige un service d’art-thérapie et est responsable d’un DU d’art-thérapie, en présence du président de l’ARAT, Mr Jean Louis Aguilar. Lequel a fait venir le Dr François Granier, dont il est un élève, à Rochegude. Ce dernier va communiquer dans l’après midi (il sera à lire dans le volet 3 du compte rendu de notre colloque). Lors de l’Assemblée Générale de l’ARAT du 2 avril 2016 à Béziers, à laquelle assistait le président de Psy Cause en tant que membre, Mr Jean Louis Aguilar affirmait sa volonté de faire reconnaître en France le métier d’art-thérapeute.
Ce colloque Rochegude III fait l’objet d’un partenariat, décidé lors de la réunion du 12 septembre 2015, avec une association qui fait la promotion de l’art-thérapie, basée à Béziers, l’ARAT. Lors de ce déjeuner, les président et vice président de Psy Cause International ont fait la connaissance du Dr François Granier, psychiatre au CHU de Toulouse où il dirige un service d’art-thérapie et est responsable d’un DU d’art-thérapie, en présence du président de l’ARAT, Mr Jean Louis Aguilar. Lequel a fait venir le Dr François Granier, dont il est un élève, à Rochegude. Ce dernier va communiquer dans l’après midi (il sera à lire dans le volet 3 du compte rendu de notre colloque). Lors de l’Assemblée Générale de l’ARAT du 2 avril 2016 à Béziers, à laquelle assistait le président de Psy Cause en tant que membre, Mr Jean Louis Aguilar affirmait sa volonté de faire reconnaître en France le métier d’art-thérapeute.
 Le rire va bon train autour de Mme Bénédicte Carrière. Après sa communication en fin de matinée sur ses ateliers clown, elle a partagé avec ses voisins de table l’humour et la bonne humeur. Partout dans la salle du restaurant, d’ailleurs, les art-thérapeutes venu(e)s au colloque ont su communiquer à leurs interlocuteurs leur plaisir de l’échange. L’ouverture en direction de ces professionnels, qui est la spécificité de Rochegude III, s’est avérée très heureuse. Et, dans l’association/revue Psy Cause, cette porte ouverte à leur accueil ne se refermera pas.
Le rire va bon train autour de Mme Bénédicte Carrière. Après sa communication en fin de matinée sur ses ateliers clown, elle a partagé avec ses voisins de table l’humour et la bonne humeur. Partout dans la salle du restaurant, d’ailleurs, les art-thérapeutes venu(e)s au colloque ont su communiquer à leurs interlocuteurs leur plaisir de l’échange. L’ouverture en direction de ces professionnels, qui est la spécificité de Rochegude III, s’est avérée très heureuse. Et, dans l’association/revue Psy Cause, cette porte ouverte à leur accueil ne se refermera pas.
 La réussite d’un colloque s’évalue par la congruence du niveau scientifique des communications et des échanges d’une part, et de la dynamique du groupe d’autre part, que l’on repère communément sous le vocable d’ambiance. Le déroulement de ce déjeuner de Rochegude III, outre la qualité des communications, nous incite à persévérer dans l’organisation de ces Journées. Un Rochegude IV en 2017 est évoqué au cours de ce repas.
La réussite d’un colloque s’évalue par la congruence du niveau scientifique des communications et des échanges d’une part, et de la dynamique du groupe d’autre part, que l’on repère communément sous le vocable d’ambiance. Le déroulement de ce déjeuner de Rochegude III, outre la qualité des communications, nous incite à persévérer dans l’organisation de ces Journées. Un Rochegude IV en 2017 est évoqué au cours de ce repas.
 De surcroit, le soleil est au rendez vous. Il l’a d’ailleurs toujours été. Le Pr Gérard Pirlot a ainsi tenu une causerie informelle en extérieur du restaurant à la sortie du déjeuner. Il a parlé de son enseignement à l’université et de certaines spécificités de l’approche de la psychanalyse par la Société Psychanalytique de Paris, en particulier en se démarquant de la psychanalyse lacanienne. Ce qui a beaucoup intéressé son auditoire.
De surcroit, le soleil est au rendez vous. Il l’a d’ailleurs toujours été. Le Pr Gérard Pirlot a ainsi tenu une causerie informelle en extérieur du restaurant à la sortie du déjeuner. Il a parlé de son enseignement à l’université et de certaines spécificités de l’approche de la psychanalyse par la Société Psychanalytique de Paris, en particulier en se démarquant de la psychanalyse lacanienne. Ce qui a beaucoup intéressé son auditoire.
« Art et existence à travers l’œuvre du philosophe Henri Maldiney » : l’auteur de cette communication est le Dr Jean Louis Griguer, Président Psy Cause des colloques de Rochegude, psychiatre chef de pôle au CHS Le Valmont à Valence, docteur en philosophie, rédacteur de la revue Psy Cause.
 Henry Maldiney (1912 – 2013) est un philosophe intéressé par l’esthétique. Il est l’un des représentants en France de la phénoménologie. Son œuvre a été influencée par Husserl, Heidegger et Binswanger. Ses champs de réflexion ont concerné la maladie mentale comme fléchissement des modalités d’existence, l’art (surtout la peinture), la psychiatrie (notamment la psychopathologie) et, bien sûr la philosophie. Il s’est posé la question « qui est artiste ? » et non celle « qu’est ce qu’un artiste ? ». C’est que, nous dit Jean Louis Griguer, ce n’est pas rien de consacrer sa vie à une œuvre et ainsi de prendre des risques. Entre l’exceptionnalité et le pathologique, y a t’il une continuité ? La création d’une œuvre met elle sur le métier ou en question l’identité du créateur ? La création artistique est imprécisable et nous pouvons nous demander qu’est ce qui fait qu’une œuvre est hors norme.
Henry Maldiney (1912 – 2013) est un philosophe intéressé par l’esthétique. Il est l’un des représentants en France de la phénoménologie. Son œuvre a été influencée par Husserl, Heidegger et Binswanger. Ses champs de réflexion ont concerné la maladie mentale comme fléchissement des modalités d’existence, l’art (surtout la peinture), la psychiatrie (notamment la psychopathologie) et, bien sûr la philosophie. Il s’est posé la question « qui est artiste ? » et non celle « qu’est ce qu’un artiste ? ». C’est que, nous dit Jean Louis Griguer, ce n’est pas rien de consacrer sa vie à une œuvre et ainsi de prendre des risques. Entre l’exceptionnalité et le pathologique, y a t’il une continuité ? La création d’une œuvre met elle sur le métier ou en question l’identité du créateur ? La création artistique est imprécisable et nous pouvons nous demander qu’est ce qui fait qu’une œuvre est hors norme.
Henry Maldiney a abordé ce questionnement sous l’angle du « phénomène ». Ce mot vient du grec « apparaître ». Il est utilisé à décrire le comment de la chose, ce qui se montre dans l’immédiat. Il ne s’agit pas de rechercher une cause ou un but, mais d’étudier ce qui apparaît, ce qui est.
Le premier chemin d’Henri Maldiney est donc l’œuvre « qui apparaît ». Lorsqu’apparaît, avec Cézanne,  la montagne Sainte Victoire, une « rencontre » s’opère. Ce n’est pas la rencontre d’un sujet et d’un objet, mais la rencontre de l’œuvre elle même qui constitue celui qui la regarde, comme une révélation. Cette rencontre est un événement, un surgissement sans préalable ; elle est inobjectivable. Henri Maldiney distingue l’art existentiel et l’art illustratif. Ce dernier donne l’mage d’un sujet, d’un personnage ; il est une imitation de ce qu’il reproduit ; il n’est pas de l’art. L’art reproductif est un document et non une œuvre. Dès lors que Cézanne crée la montagne Sainte Victoire, l’œuvre s’individualise du créateur par elle même. C’est une désappropriation de l’œuvre par rapport au créateur, comme l’enfant par rapport au parent. Il y a alors, d’un côté, l’existence de celui qui crée, et de l’autre, l’existant de ce qui a été créé. L’œuvre d’art se suffit à elle même. Pour l’appréhender, il n’est pas nécessaire de sa rapporter à l’histoire de sa création.
la montagne Sainte Victoire, une « rencontre » s’opère. Ce n’est pas la rencontre d’un sujet et d’un objet, mais la rencontre de l’œuvre elle même qui constitue celui qui la regarde, comme une révélation. Cette rencontre est un événement, un surgissement sans préalable ; elle est inobjectivable. Henri Maldiney distingue l’art existentiel et l’art illustratif. Ce dernier donne l’mage d’un sujet, d’un personnage ; il est une imitation de ce qu’il reproduit ; il n’est pas de l’art. L’art reproductif est un document et non une œuvre. Dès lors que Cézanne crée la montagne Sainte Victoire, l’œuvre s’individualise du créateur par elle même. C’est une désappropriation de l’œuvre par rapport au créateur, comme l’enfant par rapport au parent. Il y a alors, d’un côté, l’existence de celui qui crée, et de l’autre, l’existant de ce qui a été créé. L’œuvre d’art se suffit à elle même. Pour l’appréhender, il n’est pas nécessaire de sa rapporter à l’histoire de sa création.
Le second chemin d’Henri Maldiney est « l’imprévisibilité » de l’apparition d’une œuvre « sans usage ». L’artiste ne sait pas quand il va faire « son » œuvre d’art. Henri Maldiney utilise le mot « sentir ». Sentir n’est pas percevoir. Le sentir est au percevoir ce que l’écrit est au mot. Le sentir est de l’ordre de la présence, du « il y a ». Avec lui, on a une perception du monde. Sentir, c’est être en présence, exister, se tenir ouvert à. Nous sommes là dans la définition de l’art existentiel : il n’y a pas d’art sans ouverture. Or ce sentir s’accomplit dans l’exister qui est une possibilité dans chacun de nous. L’art est une manière d’exister, de ressentir et de sentir. L’art, ce n’est pas connaître, mais apprendre et comprendre. Le sentir est dans l’accès au phénomène, dans le « j’y suis » : il faut y être comme devant un tableau de Cézanne. L’œuvre d’art vous fait exister et vous ouvre au monde. Une œuvre d’art est un moment exceptionnel de rencontre qui change celui qui la regarde. Henri Maldiney parle de « l’espace Cézannien » qui est un champ de tension. Selon lui, il faut qu’il y ait « forme ». L’œuvre d’art est un moment aperturel, un moment d’ouverture et non opérationnel car l’œuvre d’art n’est pas un objet technique. L’œuvre d’art est « sans usage », ce qui est exceptionnel.
 Quel est le devenir de l’œuvre ? Pour que l’œuvre existe, il faut qu’il y ait une coupure du cordon ombilical. Lorsqu’une œuvre est terminée, elle échappe à son créateur.
Quel est le devenir de l’œuvre ? Pour que l’œuvre existe, il faut qu’il y ait une coupure du cordon ombilical. Lorsqu’une œuvre est terminée, elle échappe à son créateur.
Qu’en est il de la création de l’œuvre d’art par rapport au malade mental ? Selon Maldiney, la création de l’œuvre d’art répond à un projet du créateur. Donc, pour l’être souffrant, pour le malade, il y aurait à la fois un projet et un appel. Maldiney prend des exemples au niveau de l’art brut où la signification de l’œuvre inclut une manière pathique d’être au monde. Il y a bien création chez le malade mais est-ce d’une œuvre qui peut s’inscrire ? Ce qui est créé, est il appel ou art existentiel ?
Pour créer une œuvre d’art : mettre sa vie en jeu. La construction d’une œuvre d’art est aussi une construction de soi. Elle exige de mettre sa vie en jeu, ce qui est source d’inconfort. La rencontre avec l’œuvre d’art est également une création pour celui qui la reçoit, qui comprend et apprend. Se construire par la rencontre est l’intérêt essentiel de l’œuvre d’art pour laquelle le créateur met beaucoup de travail, consacre sa vie. Au delà du projet, il y a le saut.
Après ce mot de la fin, la discussion est très animée mettant l’accent sur la rencontre très personnelle avec l’art. Certaines toiles nous parlent, d’autres non. La rencontre est toujours unique. Il est constaté qu’on peut vivre sans art, mais on vit moins bien.
Nous allons ponctuer le récit du colloque Rochegude III, en achevant ce second volet sur cette première communication de l’après midi.
Jean Paul Bossuat et Jean Louis Griguer
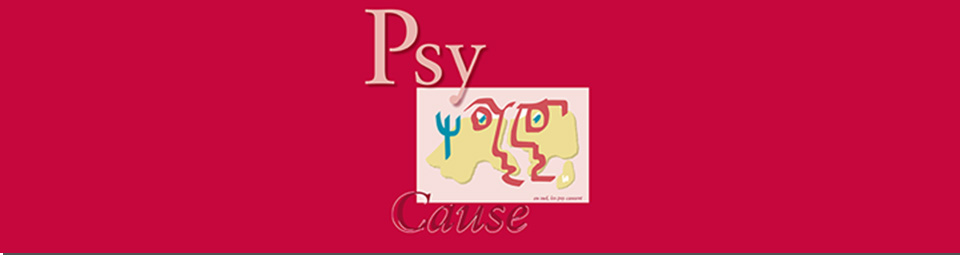
Pas de Commentaires
Trackbacks/Pingbacks