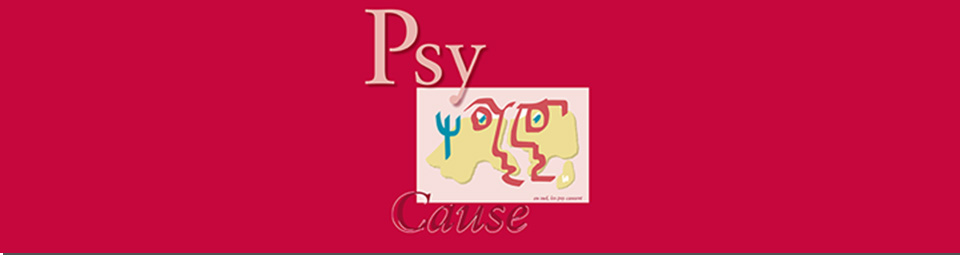Psy Cause en Guyane (carnet N°5) : un siècle de bagne
 Pendant un siècle, de 1852 où la France du Second Empire envoie le premier contingent de bagnards à 1946 où la IVème République rapatrie les 145 derniers détenus, le territoire de la Guyane Française a été associé à l’image peu flatteuse de dépotoir et de lieu de châtiment chargé de nettoyer le territoire métropolitain des individus dangereux et des petits délinquants multirécidivistes irrécupérables. Près de 90 000 condamnés y ont souffert et, pour la plupart, trouvé la mort. Le bagne a ses célébrités : un prisonnier politique qui a provoqué un vaste débat dans notre pays et fait la célébrité de Zola, Dreyfus, un meurtrier probablement victime d’une erreur judiciaire, Seznec, et un grand conteur, Papillon. Les « pensionnaires » de cet enfer vert étaient des individus dont on était bien content de se débarrasser : depuis d’authentiques terroristes comme les anarchistes de la bande à Bonnot, des assassins, des escrocs qui ont ruiné des vies, jusqu’aux petits malfrats cambrioleurs et voleurs à répétition qui empoisonnent la vie quotidienne des honnêtes gens. L’usage de ce bagne interpelle notre conscience et demeure très actuel alors que divers pays d’Europe sont endeuillés par les terroristes islamistes et que les politiques sont conduits à voter de nouvelles lois plus coercitives. Il pose la question de fond : jusqu’où aller dans l’atteinte à la condition humaine pour punir et dissuader ?
Pendant un siècle, de 1852 où la France du Second Empire envoie le premier contingent de bagnards à 1946 où la IVème République rapatrie les 145 derniers détenus, le territoire de la Guyane Française a été associé à l’image peu flatteuse de dépotoir et de lieu de châtiment chargé de nettoyer le territoire métropolitain des individus dangereux et des petits délinquants multirécidivistes irrécupérables. Près de 90 000 condamnés y ont souffert et, pour la plupart, trouvé la mort. Le bagne a ses célébrités : un prisonnier politique qui a provoqué un vaste débat dans notre pays et fait la célébrité de Zola, Dreyfus, un meurtrier probablement victime d’une erreur judiciaire, Seznec, et un grand conteur, Papillon. Les « pensionnaires » de cet enfer vert étaient des individus dont on était bien content de se débarrasser : depuis d’authentiques terroristes comme les anarchistes de la bande à Bonnot, des assassins, des escrocs qui ont ruiné des vies, jusqu’aux petits malfrats cambrioleurs et voleurs à répétition qui empoisonnent la vie quotidienne des honnêtes gens. L’usage de ce bagne interpelle notre conscience et demeure très actuel alors que divers pays d’Europe sont endeuillés par les terroristes islamistes et que les politiques sont conduits à voter de nouvelles lois plus coercitives. Il pose la question de fond : jusqu’où aller dans l’atteinte à la condition humaine pour punir et dissuader ?
 Un journaliste français déjà célèbre avant son reportage, Albert Londres, décida en 1923 d’enquêter sur le pénitencier de Guyane. À cette date, près de 7000 condamnés, surveillés par 600 fonctionnaires, vivent à Saint Laurent du Maroni et sur les îles du Salut. Les conditions de vie des bagnards n’étaient guère connues par le grand public qui, sans doute, avait d’autres préoccupations que de s’apitoyer sur le sort de tristes personnages qui l’avaient bien cherché. Or ce reportage(1), publié dans Le Petit Parisien, connut d’emblée un retentissement considérable, et sa force fut si grande qu’en septembre 1924, le gouvernement décida la suppression du bagne, sur l’avis du ministre des colonies interpelé par le journaliste, Daladier. Comme la fermeture de Guantanamo, cela prit du temps. Le dernier convoi de bagnards partit en 1938. Il fallut au total 22 ans pour que la décision soit intégralement exécutée… Quoiqu’il en soit, cette réaction de la population, une dizaine d’années avant que ne débute le délire concentrationnaire nazi, est à l’honneur de la France.
Un journaliste français déjà célèbre avant son reportage, Albert Londres, décida en 1923 d’enquêter sur le pénitencier de Guyane. À cette date, près de 7000 condamnés, surveillés par 600 fonctionnaires, vivent à Saint Laurent du Maroni et sur les îles du Salut. Les conditions de vie des bagnards n’étaient guère connues par le grand public qui, sans doute, avait d’autres préoccupations que de s’apitoyer sur le sort de tristes personnages qui l’avaient bien cherché. Or ce reportage(1), publié dans Le Petit Parisien, connut d’emblée un retentissement considérable, et sa force fut si grande qu’en septembre 1924, le gouvernement décida la suppression du bagne, sur l’avis du ministre des colonies interpelé par le journaliste, Daladier. Comme la fermeture de Guantanamo, cela prit du temps. Le dernier convoi de bagnards partit en 1938. Il fallut au total 22 ans pour que la décision soit intégralement exécutée… Quoiqu’il en soit, cette réaction de la population, une dizaine d’années avant que ne débute le délire concentrationnaire nazi, est à l’honneur de la France.
Comme il est à l’honneur de notre pays, de déclarer monuments historiques, les traces de cette illusion pénitenciaire. Lors de notre repérage cette première quinzaine de mars, nous avons visité ces structures tant à Saint Laurent du Maroni qu’aux îles du Salut. Elles seront évidemment au programme du groupe des congressistes en mars 2017.
 Le décret du 16 mars 1880 fait de Saint Laurent du Maroni, créé en 1857 en tant que colonie pénitentiaire agricole, une « commune pénitentiaire » gouvernée par des membres de l’Administration Pénitenciaire. Ce statut unique dans la République répond à la nécessité d’y regrouper, en plus des bagnards, les « libérés » astreints à « doubler » leur peine en Guyane, qui sont de plus en plus nombreux et dont la présence à Cayenne est redoutée. Ce doublage répondait à deux objectifs : accroître la population de la Guyane et retarder le plus possible le risque de récidive lors du retour en métropole. Mais très peu de bagnards libérés trouvent un travail correctement rémunéré. Albert Londres s’interroge : « Que font-ils ? D’abord ils font pitié. Ensuite ils ne font rien. (…) Alors, hors des prisons, sans un sou, portant tous sur le front, comme au fer rouge et comme recommandation : ancien forçat ; avilis, à la fois révoltés et mâtés, minés par la fièvre, redressés par le tafia, vont, râlent, invectivent, volent et jouent du couteau, les parias de Saint Laurent. Leur formule est juste : le bagne commence à la libération. » La mairie de la commune pénitentiaire est un bel exemple architectural des constructions réalisées à partir de briques fabriquées par les bagnards, assemblées par une main d’œuvre gratuite.
Le décret du 16 mars 1880 fait de Saint Laurent du Maroni, créé en 1857 en tant que colonie pénitentiaire agricole, une « commune pénitentiaire » gouvernée par des membres de l’Administration Pénitenciaire. Ce statut unique dans la République répond à la nécessité d’y regrouper, en plus des bagnards, les « libérés » astreints à « doubler » leur peine en Guyane, qui sont de plus en plus nombreux et dont la présence à Cayenne est redoutée. Ce doublage répondait à deux objectifs : accroître la population de la Guyane et retarder le plus possible le risque de récidive lors du retour en métropole. Mais très peu de bagnards libérés trouvent un travail correctement rémunéré. Albert Londres s’interroge : « Que font-ils ? D’abord ils font pitié. Ensuite ils ne font rien. (…) Alors, hors des prisons, sans un sou, portant tous sur le front, comme au fer rouge et comme recommandation : ancien forçat ; avilis, à la fois révoltés et mâtés, minés par la fièvre, redressés par le tafia, vont, râlent, invectivent, volent et jouent du couteau, les parias de Saint Laurent. Leur formule est juste : le bagne commence à la libération. » La mairie de la commune pénitentiaire est un bel exemple architectural des constructions réalisées à partir de briques fabriquées par les bagnards, assemblées par une main d’œuvre gratuite.
 Tous les bagnards, à leur arrivée, étaient débarqués à peu près à l’emplacement de la statue du bagnard, et se dirigeaient vers l’entrée du camp de transportation. C’est là qu’ils trouvaient leur affectation qui selon les cas pouvait laisser espérer la survie où conduire à la mort certaine par la maladie. Ils y arrivaient directement en bateau depuis la France. Ils étaient dirigés ensuite vers l’ensemble des camps de la Guyane : Cayenne, les îles du Salut, Saint Jean du Maroni, ou restaient à Saint Laurent. L’administration distinguait quatre catégories de bagnards : les « transportés », c’est à dire les condamnés aux travaux forcés, qui étaient les plus nombreux ; les « libérés », c’est à dire les transportés qui avaient achevé leur peine et qui devaient la doubler en étant assignés à résidence à Saint Laurent , à vie si la peine est supérieure à 8 ans ; les « relégués » qui étaient des petits délinquants multirécidivistes exilés en Guyane en principe non astreints au travaux forcés, les cas les plus lourds devant travailler et internés au camp de relégation de Saint Jean du Maroni ; les « déportés » (quelques centaines envoyés aux îles du Salut comme Dreyfus isolé dans l’île du Diable).
Tous les bagnards, à leur arrivée, étaient débarqués à peu près à l’emplacement de la statue du bagnard, et se dirigeaient vers l’entrée du camp de transportation. C’est là qu’ils trouvaient leur affectation qui selon les cas pouvait laisser espérer la survie où conduire à la mort certaine par la maladie. Ils y arrivaient directement en bateau depuis la France. Ils étaient dirigés ensuite vers l’ensemble des camps de la Guyane : Cayenne, les îles du Salut, Saint Jean du Maroni, ou restaient à Saint Laurent. L’administration distinguait quatre catégories de bagnards : les « transportés », c’est à dire les condamnés aux travaux forcés, qui étaient les plus nombreux ; les « libérés », c’est à dire les transportés qui avaient achevé leur peine et qui devaient la doubler en étant assignés à résidence à Saint Laurent , à vie si la peine est supérieure à 8 ans ; les « relégués » qui étaient des petits délinquants multirécidivistes exilés en Guyane en principe non astreints au travaux forcés, les cas les plus lourds devant travailler et internés au camp de relégation de Saint Jean du Maroni ; les « déportés » (quelques centaines envoyés aux îles du Salut comme Dreyfus isolé dans l’île du Diable).
 La visite du camp de transportation commence par l’exposition d’un « pousse », wagonnet inspiré de celui des mines et qui est un mode de locomotion très efficace propulsé par des bagnards, qui relie l’ensemble des camps dépendant de Saint Laurent du Maroni. Albert Londres en donne une description très vivante lors de son voyage jusqu’au camp forestier de Charvein, un camp de la mort : « Il s’appelait ben Gadour. C’était un sidi. En sa qualité de pousseur chef de Saint Laurent du Maroni, je le fréquentais toute la journée. Chaque matin, à six heures, ben Gadour, appuyé sur son carrosse, m’attendait au bout de la rue de la République. Ce carrosse à quatre roues minuscules roulait sur rails Decauville. C’est le pousse, car il ne roule que lorsqu’on le pousse. »
La visite du camp de transportation commence par l’exposition d’un « pousse », wagonnet inspiré de celui des mines et qui est un mode de locomotion très efficace propulsé par des bagnards, qui relie l’ensemble des camps dépendant de Saint Laurent du Maroni. Albert Londres en donne une description très vivante lors de son voyage jusqu’au camp forestier de Charvein, un camp de la mort : « Il s’appelait ben Gadour. C’était un sidi. En sa qualité de pousseur chef de Saint Laurent du Maroni, je le fréquentais toute la journée. Chaque matin, à six heures, ben Gadour, appuyé sur son carrosse, m’attendait au bout de la rue de la République. Ce carrosse à quatre roues minuscules roulait sur rails Decauville. C’est le pousse, car il ne roule que lorsqu’on le pousse. »
 « Tantôt il parcourt les dix sept kilomètres jusqu’à Saint Jean, tantôt les vingt deux, jusqu’à Charvein. Saluons très bas ce véhicule. C’est, en 1923, l’unique moyen de transport en Guyane française. Ben Gadour et ses deux aides poussaient ferme. À travers la brousse nous allions à Charvein, chez les incos (…). Passé le camp malgache, nous entrions au camp Godebert. Nous étions en pleine forêt vierge. Le tintamarre des roues sur les rails remplissait les singes rouges de terreur. Ils détalaient comme des lapins, à travers branches.
« Tantôt il parcourt les dix sept kilomètres jusqu’à Saint Jean, tantôt les vingt deux, jusqu’à Charvein. Saluons très bas ce véhicule. C’est, en 1923, l’unique moyen de transport en Guyane française. Ben Gadour et ses deux aides poussaient ferme. À travers la brousse nous allions à Charvein, chez les incos (…). Passé le camp malgache, nous entrions au camp Godebert. Nous étions en pleine forêt vierge. Le tintamarre des roues sur les rails remplissait les singes rouges de terreur. Ils détalaient comme des lapins, à travers branches.
– Ti veux t’arrêter camp Godebert ? demande ben Gadour.
– Oh ! tu sais, ben Gadour, ces camps, c’est toujours la même chose.
– T’as bien raison, toujours faire le stère, toujours crèver. »
 « Et ben Gadour lançait sa machine sur les rails à cinquante à l’heure.
« Et ben Gadour lançait sa machine sur les rails à cinquante à l’heure.
– Tu vas me casser la figure, ben Gadour.
– Ça, jamais ! je casse la figure de qui je veux ; de qui je veux pas, jamais !
À cette vitesse, on dansait dans ce carrosse sans plus de sécurité que sur une corde raide. (…) Ben Gadour ayant poussé pendant vingt deux kilomètres, s’arrêta et dit : – Tiens ! voilà la capitale du crime. »
Albert Londres décrit alors un véritable camp de la mort. « C’était le camp Charvein. (…) C’est le camp des Incos. L’homme de Charvein n’est plus un transporté, mais un disciplinaire. Tous les indomptables du bagne ont passé par là. Ils ont les cheveux coupés en escalier et sont complètement nus. (…) La pioche sur l’épaule, ils passaient, rien qu’en chair et en os, sous le lourd soleil. Un surveillant, un révolver à droite, carabine à gauche, suivait d’un pas pesant. (…) Les moustiques se gorgent sur les corps. » Albert Londres va plus loin encore dans la description de l’horreur à propos d’un chantier de construction de la route cononiale N°1.
« Nous arrivons au kilomètre 24. C’est le bout du monde. Et pour la première fois, je vois le bagne ! Ils sont là cent hommes, tous la maladie au ventre. Ceux qui sont debout, ceux qui sont couchés, ceux qui gémissent comme des chiens. (…) Ce n’est pas un camp de travailleurs, c’est une cuvette bien cachée dans les forêts de Guyane, où l’on jette des hommes qui n’en remonteront plus. Vingt quatre kilomètres dans ces conditions là, mais c’est magnifique en soixante ans ! (…) Pourtant la question serait de savoir si l’on veut faire une route ou si l’on veut faire crever des individus. Si c’est pour faire crever des individus, ne changez rien ! Tout va bien ! Si c’est pour faire une route… D’abord, ils ne mangent pas à leur faim (…). Ensuite ils sont pieds nus (…), c’est à dire sur le flanc, leurs pieds ne les portant plus : chiques, araignées des criques, pian-bois (plaies ulcéreuses). C’est affreux à voir… (…) Ce n’est que l’extérieur, ce qui se voit. Le mal qui les mine en dedans s’appelle ankilostomiase. Ce sont des vers infiniment petits, qui désagrègent l’intestin. Tous les bagnards en sont atteints. C’est ce qui leur vaut ce teint de chandelle, ce ventre concave, et qui fait que plus l’heure approche où leurs yeux se fermeront, plus leurs yeux s’agrandissent. Pour eux, la quinine étant considérée comme un bonbon, on ne leur en donne que lorsqu’ils sont sages ; alors la fièvre accourt tambour battant dans ce champ de bataille. »
Quelle est la différence entre un camp de la mort nazi et un tel chantier ? Une seule : ces hommes ont commis des crimes ou de graves délits. Ils ne sont pas là pour l’unique raison qu’ils sont des innocents indésirables. Quant à ceux qui se trouveront en Allemagne dans de tels camps parce qu’ils auront résisté à l’occupant et fait dérailler un train… la différence devient bien mince. Une question de fond : peut on justifier de traiter ainsi un être humain ?
 La suite de la visite du camp de transportation est impressionnante avec les cellules disciplinaires d’isolement sensoriel où l’on pouvait passer des mois dans l’obscurité et le silence, la torture par les fers… Mais le plus terrible est la vie ordinaire dans le dortoir appelé blockhaus. Il est prévu pour 40 bagnards mais la surpopulation, un mal bien français, sévissait. Un certain nombre de prisonniers avaient les pieds enchaînés et devaient faire leurs besoins sous eux. L’unique toilette était insuffisante, la puanteur était telle que les surveillants n’entraient pas et laissaient la gestion des bagarres aux « portes clés », des bagnards de confiance, kapos avant la lettre.
La suite de la visite du camp de transportation est impressionnante avec les cellules disciplinaires d’isolement sensoriel où l’on pouvait passer des mois dans l’obscurité et le silence, la torture par les fers… Mais le plus terrible est la vie ordinaire dans le dortoir appelé blockhaus. Il est prévu pour 40 bagnards mais la surpopulation, un mal bien français, sévissait. Un certain nombre de prisonniers avaient les pieds enchaînés et devaient faire leurs besoins sous eux. L’unique toilette était insuffisante, la puanteur était telle que les surveillants n’entraient pas et laissaient la gestion des bagarres aux « portes clés », des bagnards de confiance, kapos avant la lettre.
 Les crimes commis au bagne étaient sanctionnés par la guillotine. Le bourreau est lui même un bagnard. La Guyane a conservé le souvenir de l’un d’entre eux qui s’efforçait d’accomplir son ouvrage avec professionnalisme et humanité. Il s’appelait Hespel, dit Chacal. Un jour, il commit lui même un meurtre. Lorsque vint pour lui le moment de monter à l’échafaud, il y avait deux exécutions prévues. Il demanda la faveur d’être exécuté en second… car il voulait s’assurer que son remplaçant faisait correctement le travail. Dans la cour du camp de transportation où s’érigeait occasionnellement la guillotine, un puits était utilisé pour laver les têtes des bagnards exécutés, qui étaient ensuite conservées dans du formol pour des études scientifiques.
Les crimes commis au bagne étaient sanctionnés par la guillotine. Le bourreau est lui même un bagnard. La Guyane a conservé le souvenir de l’un d’entre eux qui s’efforçait d’accomplir son ouvrage avec professionnalisme et humanité. Il s’appelait Hespel, dit Chacal. Un jour, il commit lui même un meurtre. Lorsque vint pour lui le moment de monter à l’échafaud, il y avait deux exécutions prévues. Il demanda la faveur d’être exécuté en second… car il voulait s’assurer que son remplaçant faisait correctement le travail. Dans la cour du camp de transportation où s’érigeait occasionnellement la guillotine, un puits était utilisé pour laver les têtes des bagnards exécutés, qui étaient ensuite conservées dans du formol pour des études scientifiques.
 Cette même cour conserve la cellule N°47 qui a hébergé un hôte illustre, Henri Charrière plus connu sous le pseudonyme de « Papillon ». Ce dernier a laissé une trace de sa présence dans sa cellule en gravant son pseudonyme. Le livre qui l’a rendu célèbre est un roman soi disant autobiographique qui reprend des fragments de vie de compagnons d’infortune qu’il avait croisés. Une autre trace, plus émouvante encore, est à lire de l’autre côté de la cour dans l’une des cellules des condamnés à mort : « Adieu Maman ». Ailleurs, dans une cellule d’isolement, on retrouve des bâtonnets gravés pour compter les jours à passer dans le silence et l’obscurité. Ce qui pouvait être sanctionné comme dégradation de la propriété de l’Administration Pénitenciaire. Toutes ces traces relèvent aujourd’hui d’une démarche archéologique dans un camp classé en totalité monument historique en 1994.
Cette même cour conserve la cellule N°47 qui a hébergé un hôte illustre, Henri Charrière plus connu sous le pseudonyme de « Papillon ». Ce dernier a laissé une trace de sa présence dans sa cellule en gravant son pseudonyme. Le livre qui l’a rendu célèbre est un roman soi disant autobiographique qui reprend des fragments de vie de compagnons d’infortune qu’il avait croisés. Une autre trace, plus émouvante encore, est à lire de l’autre côté de la cour dans l’une des cellules des condamnés à mort : « Adieu Maman ». Ailleurs, dans une cellule d’isolement, on retrouve des bâtonnets gravés pour compter les jours à passer dans le silence et l’obscurité. Ce qui pouvait être sanctionné comme dégradation de la propriété de l’Administration Pénitenciaire. Toutes ces traces relèvent aujourd’hui d’une démarche archéologique dans un camp classé en totalité monument historique en 1994.
 Un nombre non négligeable de bagnards parvenait à survivre jusqu’à la « libération » en faisant preuve de bonne conduite, parfois en achetant les surveillants. Ils obtenaient des postes administratifs, des fonctions d’employé de maison, voire faisaient reconnaître leur talent d’artiste. L’un d’entre eux a peint les fresques de l’église d’Iracoubo, une petite ville à mi chemin entre Saint Laurent du Maroni et Cayenne, qui sont un véritable chef d’œuvre à visiter. Il a peint avec application, ne laissant aucune surface vierge, faisant durer son travail le plus longtemps possible. À l’île Royale, c’est un peintre, faussaire de talent, ce qui lui a valu le bagne, qui a décoré l’église, mettant en avant sa foi profonde.
Un nombre non négligeable de bagnards parvenait à survivre jusqu’à la « libération » en faisant preuve de bonne conduite, parfois en achetant les surveillants. Ils obtenaient des postes administratifs, des fonctions d’employé de maison, voire faisaient reconnaître leur talent d’artiste. L’un d’entre eux a peint les fresques de l’église d’Iracoubo, une petite ville à mi chemin entre Saint Laurent du Maroni et Cayenne, qui sont un véritable chef d’œuvre à visiter. Il a peint avec application, ne laissant aucune surface vierge, faisant durer son travail le plus longtemps possible. À l’île Royale, c’est un peintre, faussaire de talent, ce qui lui a valu le bagne, qui a décoré l’église, mettant en avant sa foi profonde.
 Nous ne pouvons terminer cette brève évocation du bagne sans parler de l’île du Diable, l’une des trois îles du Salut, au large de Kourou. Laissons parler Albert Londres qui s’y est rendu, non sans peine, depuis l’île Royale : « Les condamnés appellent le Diable le « Rocher noir ». On croirait n’avoir qu’à enjamber pour passer. C’est une toute autre affaire. (…) On ne va pas comme cela vous chante chez les déportés. Un goulet sépare les deux terres. Le courant est impératif. Aucun bateau ne s’y aventure. La mer semble ici un mur hérissé de tessons de bouteilles.
Nous ne pouvons terminer cette brève évocation du bagne sans parler de l’île du Diable, l’une des trois îles du Salut, au large de Kourou. Laissons parler Albert Londres qui s’y est rendu, non sans peine, depuis l’île Royale : « Les condamnés appellent le Diable le « Rocher noir ». On croirait n’avoir qu’à enjamber pour passer. C’est une toute autre affaire. (…) On ne va pas comme cela vous chante chez les déportés. Un goulet sépare les deux terres. Le courant est impératif. Aucun bateau ne s’y aventure. La mer semble ici un mur hérissé de tessons de bouteilles.  (…) Nous voici en route depuis un quart d’heure. Nous n’avons presque pas décollé de Royale. Ce sont six rudes galériens (…) mais chaque fois qu’ils gagnent un mètre, les rouleaux nous repoussent de deux. Dans un suprême effort, les forçats enlèvent le canot. (…) Nous sautons sur le Diable. Ouvrez les bras et vous tiendrez l’île contre votre cœur. C’est tout son volume. Dreyfus l’inaugura. Il y resta cinq ans, seul. Voici son carbet. Il est abandonné. Je le regarde et c’est comme une très ancienne histoire que l’on me conterait. Voici son banc. Chaque jour, le capitaine venait s’y asseoir, les yeux fixés, dit la légende, sur la France, à quatre mille milles par l’Atlantique. » Albert Londres trouve 28 prisonniers qui ont trahi pendant la Grande Guerre : « la guerre a peuplé le Rocher. »
(…) Nous voici en route depuis un quart d’heure. Nous n’avons presque pas décollé de Royale. Ce sont six rudes galériens (…) mais chaque fois qu’ils gagnent un mètre, les rouleaux nous repoussent de deux. Dans un suprême effort, les forçats enlèvent le canot. (…) Nous sautons sur le Diable. Ouvrez les bras et vous tiendrez l’île contre votre cœur. C’est tout son volume. Dreyfus l’inaugura. Il y resta cinq ans, seul. Voici son carbet. Il est abandonné. Je le regarde et c’est comme une très ancienne histoire que l’on me conterait. Voici son banc. Chaque jour, le capitaine venait s’y asseoir, les yeux fixés, dit la légende, sur la France, à quatre mille milles par l’Atlantique. » Albert Londres trouve 28 prisonniers qui ont trahi pendant la Grande Guerre : « la guerre a peuplé le Rocher. »
 Toutes ces souffrances ne sont plus que murmures du passé, tandis qu’agit aujourd’hui en d’autres lieux la cruauté humaine. Sur la terrasse du restaurant qui surplombe, du haut de l’île Royale, l’île du Diable, un perroquet sauvage se pose pour lécher à quelques centimètres de nous, un peu de crème de notre dessert. Comme la Guyane est belle lorsque l’on n’en pervertit pas les atours pour avilir l’être humain.
Toutes ces souffrances ne sont plus que murmures du passé, tandis qu’agit aujourd’hui en d’autres lieux la cruauté humaine. Sur la terrasse du restaurant qui surplombe, du haut de l’île Royale, l’île du Diable, un perroquet sauvage se pose pour lécher à quelques centimètres de nous, un peu de crème de notre dessert. Comme la Guyane est belle lorsque l’on n’en pervertit pas les atours pour avilir l’être humain.
Nous pouvons alors conclure par ce passage de la lettre ouverte d’Albert Londres au ministre des colonies : « La Guyane est un Eldorado, mais on dirait que nous débarquons d’hier. Depuis soixante ans nous tournons et retournons autour d’une coquille qui renferme un trésor et nous n’osons pas briser cette coquille ».
Jean Paul Bossuat
(1) Albert Londres, « Au bagne », mars 2008, Arléa.